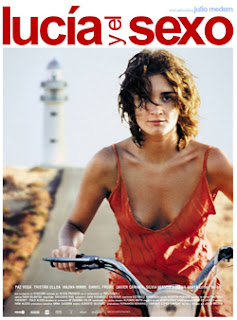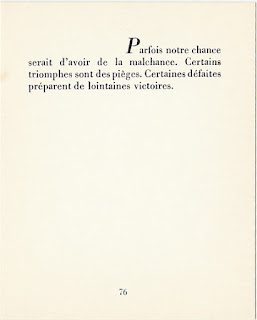Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull (Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal), 2008
À l'époque de sa sortie en 1989, certains critiques et spectateurs (pas moi) pouvaient éventuellement se laisser aller à penser que La dernière croisade était le film le plus
faible des trois alors tournés. Tout a changé en 2008 avec l'ajout de ce quatrième
titre. Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull fut
en tout honnêteté emballant sur l'instant, enthousiasmant dès ses premières minutes par la vivacité épatante de la mise en scène, par sa plongée rafraîchissante dans les fifties chères à George Lucas. Et je fus touché — pour ne pas dire ému — par les inévitables clins d'œil qui viennent titiller nos souvenirs de spectateur.
Mais, le récit se développant, et les scènes s'enchaînant, je me retrouvais vite rattrapé par un arrière-goût bizarre que je n'osais pas trop interroger. Au sortir du film, certaines images me revenaient soudain en tête, et c'est alors l'embarras qui s'est imposé, au point où j'en venais à considérer certains choix, tant narratifs qu'esthétiques, indéfendables. Les trois premiers films faisaient preuve d'une réelle intelligence dans le scénario, donnée insuffisamment présente ici (David Koepp, décidément inégal). J'avoue ne pas avoir tenté de le revoir depuis. Et peut-être faudra-t-il encore relativiser ce jugement au vu de l'annonce franchement inquiétante d'un cinquième épisode...
Mais, le récit se développant, et les scènes s'enchaînant, je me retrouvais vite rattrapé par un arrière-goût bizarre que je n'osais pas trop interroger. Au sortir du film, certaines images me revenaient soudain en tête, et c'est alors l'embarras qui s'est imposé, au point où j'en venais à considérer certains choix, tant narratifs qu'esthétiques, indéfendables. Les trois premiers films faisaient preuve d'une réelle intelligence dans le scénario, donnée insuffisamment présente ici (David Koepp, décidément inégal). J'avoue ne pas avoir tenté de le revoir depuis. Et peut-être faudra-t-il encore relativiser ce jugement au vu de l'annonce franchement inquiétante d'un cinquième épisode...
The Adventures of Tintin : secret of the unicorn (Les Aventures de Tintin : le secret de la licorne), 2011
Forcément suspicieux au moment de
m'y mettre, j'ai été conquis par la démarche visuelle dès l'ouverture sur le
marché aux puces de Bruxelles. Le mix entre le rendu photoréaliste des décors et la
stylisation des personnages aboutit en effet à quelque chose d'à la fois parfaitement
fidèle au monde d'Hergé et judicieusement calibré pour le média cinématographique. Le film nous offre tout à coup l'occasion de plonger dans la profondeur insoupçonnée d'un univers graphique pourtant tellement familier. Le tout est
porté par un scénario formidable de malice cosigné par Edgar Wright (Shaun of the dead, Scott Pilgrim), qu'on devine incontestablement connaisseur de
la bande dessinée, et ayant clairement à cœur de lui rendre dignement hommage. Sans céder à la tentation du remplissage, il mêle adroitement à son récit des éléments pertinents tirés du Crabe aux pinces d'or. Il y a du
vrai fan derrière, ça se sent et fait d'autant plus plaisir qu'Hollywood se soucie peu des questions de fidélité dans ses adaptations, du moment qu'on a sur l'affiche un nom de franchise porteur.
La réalisation délirante de
Spielberg achève de rendre le spectacle distrayant, et on sent que c'est son
seul objectif. Pas de temps mort, un enchaînement de cadres aussi variés que
dans un bon James Bond. C'est chargé d'action jusqu'à la gueule et ça culmine lors
de ce plan-séquence au Maroc dont j'imagine qu'il a du faire son petit effet
aux spectateurs des séances 3D. En soi, cette séquence de ride pourrait légitimement être considérée hors-sujet dans l'univers d'Hergé. Mais dans le rythme du film, elle s'intègre sans heurt. Un seul regret : qu'après ce climax, Spielberg
se soit senti obligé d'en rajouter un autre. En plus d'être incompréhensible et
abusivement démesurée, la baston de grue à ce stade ne nous intéresse plus, on n'y ressent plus aucune sensation de danger.
War horse (Cheval de guerre), 2011
Un vrai grand spectacle de cinéma, où Spielberg semble une nouvelle fois confirmer sa filiation avec les grands réalisateurs classiques hollywoodiens (et John Ford évidemment en première ligne).
C'est une véritable odyssée qui nous fait vibrer à travers tout un riche panel
d'émotions. Trop riche, peut-être, mais le sujet s'y prête et Spielberg
aurait eu tort de s'en priver. La vraie belle surprise est que malgré
la violence inévitable du sujet, le réalisateur fait preuve dans son regard
d'une sobriété qui rend les images encore plus fortes, dissimulant souvent la
mort tout en nous saisissant à la gorge.
Le premier acte du film est sans
doute le moins intéressant, étape obligée pour poser les bases du relation qui
va ensuite y puiser toute sa force. Mais on se laisse prendre parce que c'est
fait avec un talent admirable. Toute la maturité du metteur en scène se ressent
dans la volonté qui est la sienne de peindre des personnages touchants
(Niels Arestrup est fabuleux). En fait, le film est truffé de scènes ultra-fortes,
tant dans le thème abordé que dans la mise en scène. Je ne les citerai pas mais
ceux qui ont vu le film n'ont pas pu passer à côté. Le tout évidemment emballé
par des images somptueuses et pleines de poésie. Bref, dans le détail, on
pourra toujours reprocher une recherche de lyrisme appuyée, mais personnellement le film m'a
transporté. D'autant plus que je n'en attendais franchement rien au vu de son improbable sujet.
Lincoln, 2012
Spielberg semble désormais affranchi
des modes, faisant des films qui échappent aux catégories. Projet longtemps porté, Lincoln se présente ainsi comme un film assurément
ambitieux par son approche, sa volonté de traiter un sujet historique complexe
en circonscrivant son action quasiment aux seules alcôves du pouvoir. Ça peut
paraître limité au premier abord et pourtant, grâce à la finesse du
scénario et des dialogues, énormément de choses sont dites, l'essentiel
semblant comme projeté hors champ. On y reconnaîtra là le talent du dramaturge Tony Kushner (Angels in America, Munich), d'autant plus à l'aise ici que le film privilégie les discours aux actes. Les dilemmes moraux et politiques d'un pays
qui est alors toujours en phase de construction sont mis sur le même plan que
ceux d'un homme qui se doit d'être au-dessus des autres, de (faire) voir plus
loin. Et ça crée de vrais moments d'émotions, le metteur en scène y mettant ce
qu'il faut de sensibilité dans la peinture de la famille Lincoln, parfaitement secondé par un casting très classe à tous les niveaux (j'ai découvert au générique de fin la présence d'un James Spader méconnaissable, et Tommy Lee Jones m'a paru un peu
fatigué).
Décors et costumes créent une impression de
pesanteur qui contribue sans doute à cette sensation de voir l'Histoire en
marche, qui doit se débarrasser du poids des préjugés et traditions. Je note
aussi le montage vraiment inspiré de Michael Kahn qui par de petites
trouvailles vient mine de rien régulièrement accélérer le rythme du film par
des séquences illustratives ou par sa façon de bousculer la chronologie. À côté
de ça, on sent Spielberg tellement respectueux de son sujet (de son
protagoniste), que son film n'échappe pas toujours à un aspect un peu compassé,
même s'il a à cœur d'éviter les facilités. Un petit côté film scolaire, au
sens de destiné aux écoles, comme un travail de mémoire. Animé des mêmes intentions, Saving private Ryan avait par nature davantage de souffle. Le film ne souffre vraiment d'aucun défaut, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de revenir de sitôt vers Lincoln.
Puis, lorsque les scènes avec les soldats de l'US Air force commencent à s'intercaler, on devine où tout cela va conduire. Dès lors, le suspense m'a paru complètement éventé, me laissant avec la pénible impression que le film ne démarrait vraiment qu'au bout d'une heure, lorsque Hanks déboule à Berlin. Certes, toute cette première partie sert à montrer sa détermination à toute épreuve, mais dans ce cas j'aurais préféré qu'on nous laisse hors-champ l'histoire du pilote — sa scène de crash n'ayant plus aucune intensité, puisqu'on sait qu'il est destiné à devenir monnaie d'échange, donc à survivre. Le meilleur du film réside peut-être dans ces harassantes et parfois absurdes tractations que mène le héros, à cheval sur le rideau de fer. Là c'est souvent passionnant. Tout passant essentiellement par le dialogue, les scènes doivent une grande part de leur réussite à l'excellence de l'interprétation. Evidemment, ça fait plaisir de voir un acteur de la trempe de Hanks prolonger sa collaboration avec Spielberg, et il incarne vraiment ici une sorte de tradition du héros américain, humaniste et individualiste — dans le sens où il trace son propre chemin contre les règles — à la James Stewart chez Capra. Mais le réalisateur a beau montrer des moments pénibles (l'interrogatoire du pilote et les tentatives de franchissement du mur), je n'ai jamais pleinement ressenti angoisse et froideur. Même quand Hanks se fait agresser dans la rue, c'en est presque inconséquent. Et ce n'est pas la photo de Kaminski aux teintes bleutées qui compensera ça. L'échange final lui-même pâtit d'un suspense gentiment artificiel, on n'est jamais vraiment inquiet pour sa résolution.
Si je me permet de dire que le film ronronne, c'est parce que j'espérais davantage de tripes de la part de Spielberg pour un sujet pareil qui offrait une bonne opportunite de mélanger réflexion citoyenne et spectacle efficace, en nous plongeant dans un monde où la confiance n'est plus de mise. Pourtant, on ne peut nier qu'il est impliqué et qu'il croit à l'histoire qu'il raconte, mettant en scène cette époque de paranoïa qu'il a lui-même connu (celle que Joe Dante évoquait à sa façon dans Matinee). L'épilogue est peut-être le moment le plus réussi, trouvant le juste ton. À la lecture des notes de fin qui racontent le devenir des personnages, c'est peut-être davantage la négociation de l'avocat à Cuba qui m'aurait semblé mériter un traitement. Parce que film d'espionnage inscrit dans une réalité historique, j'avais le fabuleux Munich en ligne de mire, et espérai une réussite au moins approchante. On est ici plutôt dans la lignée du bavard Lincoln. Surprise au générique : le nom des Coen Bros. à l'écriture, et c'est sans doute à eux qu'on doit ces nombreuses répliques pleine d'esprit qui trouvent plutôt bien leur place dans un récit sérieux.
Ça commence plutôt très bien, et j'en viens aujourd'hui à ressentir du plaisir dans le simple fait de retrouver la grammaire et l'univers visuel familiers de Spielby et Kaminski. Après une admirable séquence d'ouverture, où je me suis délecté de la maîtrise confondante du réal pour introduire son personnage muet, son environnement, et mettre en scène sa filature, j'ai trouvé que le film perdait un peu vite en efficacité, jusque dans les ressorts de son intrigue. Ainsi, quel dommage de devoir tiquer après à peine 10mn, lorsqu'Abel réussit à faire disparaître son petit papier avec autant de facilité, au milieu de tous ces agents du FBI qui ont envahi son appart et qui devraient précisément être à l'affût (scène un peu gadget puisque cet élément de preuve ne servira en rien le récit par la suite). Les séquences de procès dévoilent progressivement une réflexion intéressante, où le personnage de l'avocat prend au sérieux le rôle qu'on lui a assigné, seul contre tous y compris sa famille, refusant de céder à la mascarade politique qui se met en place. On se retrouve ainsi avec un film au propos très citoyen, qui dit des choses sur le monde d'aujourd'hui, où face à de nouvelles crises la question du respect des droits fondamentaux est toujours posée.
Puis, lorsque les scènes avec les soldats de l'US Air force commencent à s'intercaler, on devine où tout cela va conduire. Dès lors, le suspense m'a paru complètement éventé, me laissant avec la pénible impression que le film ne démarrait vraiment qu'au bout d'une heure, lorsque Hanks déboule à Berlin. Certes, toute cette première partie sert à montrer sa détermination à toute épreuve, mais dans ce cas j'aurais préféré qu'on nous laisse hors-champ l'histoire du pilote — sa scène de crash n'ayant plus aucune intensité, puisqu'on sait qu'il est destiné à devenir monnaie d'échange, donc à survivre. Le meilleur du film réside peut-être dans ces harassantes et parfois absurdes tractations que mène le héros, à cheval sur le rideau de fer. Là c'est souvent passionnant. Tout passant essentiellement par le dialogue, les scènes doivent une grande part de leur réussite à l'excellence de l'interprétation. Evidemment, ça fait plaisir de voir un acteur de la trempe de Hanks prolonger sa collaboration avec Spielberg, et il incarne vraiment ici une sorte de tradition du héros américain, humaniste et individualiste — dans le sens où il trace son propre chemin contre les règles — à la James Stewart chez Capra. Mais le réalisateur a beau montrer des moments pénibles (l'interrogatoire du pilote et les tentatives de franchissement du mur), je n'ai jamais pleinement ressenti angoisse et froideur. Même quand Hanks se fait agresser dans la rue, c'en est presque inconséquent. Et ce n'est pas la photo de Kaminski aux teintes bleutées qui compensera ça. L'échange final lui-même pâtit d'un suspense gentiment artificiel, on n'est jamais vraiment inquiet pour sa résolution.
Si je me permet de dire que le film ronronne, c'est parce que j'espérais davantage de tripes de la part de Spielberg pour un sujet pareil qui offrait une bonne opportunite de mélanger réflexion citoyenne et spectacle efficace, en nous plongeant dans un monde où la confiance n'est plus de mise. Pourtant, on ne peut nier qu'il est impliqué et qu'il croit à l'histoire qu'il raconte, mettant en scène cette époque de paranoïa qu'il a lui-même connu (celle que Joe Dante évoquait à sa façon dans Matinee). L'épilogue est peut-être le moment le plus réussi, trouvant le juste ton. À la lecture des notes de fin qui racontent le devenir des personnages, c'est peut-être davantage la négociation de l'avocat à Cuba qui m'aurait semblé mériter un traitement. Parce que film d'espionnage inscrit dans une réalité historique, j'avais le fabuleux Munich en ligne de mire, et espérai une réussite au moins approchante. On est ici plutôt dans la lignée du bavard Lincoln. Surprise au générique : le nom des Coen Bros. à l'écriture, et c'est sans doute à eux qu'on doit ces nombreuses répliques pleine d'esprit qui trouvent plutôt bien leur place dans un récit sérieux.
DOSSIER STEVEN SPIELBERG :