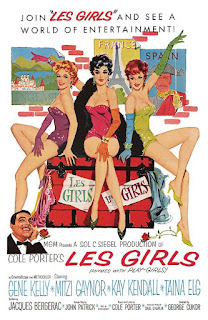Voilà bien un titre qui mérite le qualificatif de "film générationnel". Succès critique et public aux proportions pas vraiment explicables, que tout le monde semblait avoir vu à l'époque, citant des répliques, parodiant des scènes, voire se faisant remaker à Bollywood (Mohabbatein). Un phénomène d'autant plus remarquable que la jeunesse française de 1989 s'est retrouvée en phase avec le propos d'un film qui prend place dans le cadre rétro de l'Amérique des 50's. Il marque aussi la consécration de Robin Williams, formidablement attachant et émouvant dans le rôle de ce professeur Keating, personnage parfois pas loin du stand-up comedian qui lui permet de pleinement développer sa palette de jeu. Face à son auditoire, adolescents fragiles dans une société corsetée, il agit comme un révélateur, bousculant les conventions pédagogiques et puisant dans la poésie comme dans le sport les ressources de la liberté et de l'émancipation.
Après les jeunes filles de Picnic at Hanging rock, après River Phoenix dans Mosquito coast, Weir se montre une nouvelle fois à l'aise avec la direction de jeunes acteurs. On mettait à l'époque beaucoup d'espoir dans le devenir du casting. On recroisera encore Robert Sean Leonard dans le réjouissant Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh, mais finalement seul Ethan Hawke est encore vraiment là aujourd'hui, même s'il a rarement eu les honneurs du premier rôle.
Enfin, si on attendait pas forcément Weir dans ce drame en velours côtelé, force est de constater que le réalisateur livre un produit impeccablement fini, manipulant efficacement les émotions du spectateur (indignation, tristesse, exaltation, etc.). Profitant du passage des saisons, la photographie de John Seale est somptueuse, et en plus des atmosphères composées par Maurice Jarre, Weir enrichit sa bande son de pièces de musique classique qui achèvent de rendre certaines scènes inoubliables (L'Hymne à la joie). Bref, voilà bien une œuvre emblématique du cinéma américain, qui basculait alors dans une nouvelle décennie, celle de la grande époque du studio Touchstone, filiale adulte de Disney qui produira encore le film suivant du cinéaste :
Après les jeunes filles de Picnic at Hanging rock, après River Phoenix dans Mosquito coast, Weir se montre une nouvelle fois à l'aise avec la direction de jeunes acteurs. On mettait à l'époque beaucoup d'espoir dans le devenir du casting. On recroisera encore Robert Sean Leonard dans le réjouissant Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh, mais finalement seul Ethan Hawke est encore vraiment là aujourd'hui, même s'il a rarement eu les honneurs du premier rôle.
Enfin, si on attendait pas forcément Weir dans ce drame en velours côtelé, force est de constater que le réalisateur livre un produit impeccablement fini, manipulant efficacement les émotions du spectateur (indignation, tristesse, exaltation, etc.). Profitant du passage des saisons, la photographie de John Seale est somptueuse, et en plus des atmosphères composées par Maurice Jarre, Weir enrichit sa bande son de pièces de musique classique qui achèvent de rendre certaines scènes inoubliables (L'Hymne à la joie). Bref, voilà bien une œuvre emblématique du cinéma américain, qui basculait alors dans une nouvelle décennie, celle de la grande époque du studio Touchstone, filiale adulte de Disney qui produira encore le film suivant du cinéaste :
Green card, 1990
Après un tel triomphe commercial, Weir a sans doute eu Hollywood à ses pieds, et aurait pu en profiter pour faire aboutir des projets qui lui tenaient à cœur, lui dont on sait le goût pour les sujets risqués. Mais à défaut d'une carte blanche, son film suivant sera donc ce Green card, comédie romantique pépèrement tournée à New York et parfaitement inoffensive, qui n'a jamais suscité ma curiosité. Il en est pourtant pleinement l'auteur, mettant en scène son propre scénario.
J'imagine un divertissement taillé sur mesure pour ses deux superstars. Auréolée du succès de Sexe, mensonges & vidéo, Andie McDowell est alors sur la phase ascendante de sa carrière, et l'actrice va bientôt être incontournable dans ce registre (Un jour sans fin, Quatre mariages et un enterrement). Quant à Depardieu, son génie venait d'être coulé dans le marbre suite à Cyrano De Bergerac, et il tentait là l'aventure hollywoodienne, qui ne sera jamais bien concluante (en dehors de 1492, ça donnera en effet surtout des produits sans ambition comme L'Homme au masque de fer, Les 102 dalmatiens Wanted).

J'imagine un divertissement taillé sur mesure pour ses deux superstars. Auréolée du succès de Sexe, mensonges & vidéo, Andie McDowell est alors sur la phase ascendante de sa carrière, et l'actrice va bientôt être incontournable dans ce registre (Un jour sans fin, Quatre mariages et un enterrement). Quant à Depardieu, son génie venait d'être coulé dans le marbre suite à Cyrano De Bergerac, et il tentait là l'aventure hollywoodienne, qui ne sera jamais bien concluante (en dehors de 1492, ça donnera en effet surtout des produits sans ambition comme L'Homme au masque de fer, Les 102 dalmatiens Wanted).

Fearless (État second), 1993
Pas vu non plus... Le film semble être un peu être passé inaperçu à sa sortie, et durant cette décennie la carrière de Weir va connaître d'inexplicables difficultés. Il va lui falloir un peu de temps avant de retrouver les faveurs du public.
Fearless affichait pourtant beau casting (Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Benicio Del Toro, John Turturro), et proposait un sujet intriguant puisqu'il y est question du retour à la vie d'un rescapé, thème que Weir semblait tout à fait approprié pour traiter, capable qu'il est d'y porter un regard poétique et ouvert au mysticisme.

Fearless affichait pourtant beau casting (Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Benicio Del Toro, John Turturro), et proposait un sujet intriguant puisqu'il y est question du retour à la vie d'un rescapé, thème que Weir semblait tout à fait approprié pour traiter, capable qu'il est d'y porter un regard poétique et ouvert au mysticisme.

The Truman show, 1998
C'était l'époque où Andrew Niccol était encore inspiré (je n'ai rien vu de bon sortir de lui passé Gattaca), signant ici un scénario malin mais pas idiot, intelligemment géré dans sa progression, qui ne perd pas de temps dans son exposition et fait démarrer l'action à l'instant précis où la mécanique se détraque. Tout le film expose en quelque sorte une vision de la condition humaine qui se définirait par le besoin inné de s'émanciper, et de préférer à un idéal factice son libre-arbitre. On aura beau tenter de verrouiller de toutes part le cocon, il finira fatalement par se fissurer, de lui-même, et éventuellement aidé par nos propres coups de boutoir. Le film est aussi une critique de cette american way of life idéalisée et figée à jamais dans les fifties, celle où la réussite sociale va de pair avec l'avénement des médias. Weir doit faire preuve d'inventivité pour assurer ce concept d'un monde quadrillé de caméras, d'un regard omniscient. Ça passe par une multiplication d'angles, un jeu avec les amorces en premier plan, pour suggérer que les caméras sont partout, jusque dans un taille-crayon. Et ça donne une vitalité assez inédite à son cinéma, sans pour autant en abuser, nuire à la lisibilité ou paraître gadget. Le but étant précisément de montrer la mise en scène, de nous rendre critiques dans notre propre lecture des images.
C'était l'époque où Andrew Niccol était encore inspiré (je n'ai rien vu de bon sortir de lui passé Gattaca), signant ici un scénario malin mais pas idiot, intelligemment géré dans sa progression, qui ne perd pas de temps dans son exposition et fait démarrer l'action à l'instant précis où la mécanique se détraque. Tout le film expose en quelque sorte une vision de la condition humaine qui se définirait par le besoin inné de s'émanciper, et de préférer à un idéal factice son libre-arbitre. On aura beau tenter de verrouiller de toutes part le cocon, il finira fatalement par se fissurer, de lui-même, et éventuellement aidé par nos propres coups de boutoir. Le film est aussi une critique de cette american way of life idéalisée et figée à jamais dans les fifties, celle où la réussite sociale va de pair avec l'avénement des médias. Weir doit faire preuve d'inventivité pour assurer ce concept d'un monde quadrillé de caméras, d'un regard omniscient. Ça passe par une multiplication d'angles, un jeu avec les amorces en premier plan, pour suggérer que les caméras sont partout, jusque dans un taille-crayon. Et ça donne une vitalité assez inédite à son cinéma, sans pour autant en abuser, nuire à la lisibilité ou paraître gadget. Le but étant précisément de montrer la mise en scène, de nous rendre critiques dans notre propre lecture des images.
Assurément caustique mais sans tomber dans la bouffonerie, The Truman show a l'intelligence de ne pas dilapider son propos, et de rester constamment distrayant et bien rythmé. On s'amuse vraiment de toutes les implications pratiques de ce monde artificiel, des décors qui s'arrêtent à leur façade, des figurants qui paniquent quand il faut improviser, des trouvailles pour contrer les élans naturels du protagoniste (la décoration de l'agence de voyage). Le talent de Weir est de parvenir par dessus ça à faire partager au spectateur exactement les mêmes espoirs et émotions que les spectateurs du show dans le film. Eux comme nous, ressentons la même tendresse pour le héros, au premier degré, sans cynisme. Le choc, éventuellement salutaire, se produira dans les toutes dernières secondes avec cette dernière réplique géniale des deux spectateurs qui, malgré le climax, basculent dans l'ennui et le besoin de zapper dès que le robinet à images s'arrête. Sans doute visionnaire, le film n'a à mes yeux en rien vieilli puisqu'on n'a pas particulièrement évolué de ce point de vue là, et que ce qu'il décrit a encore toute les chances de se produire. C'est un sujet qui travaillait apparemment pas mal Hollywood à l'époque puisqu'au même moment sortaient EdTV et Pleasantville, qu'on peut considérer comme des variations sur le même thème.
Portant clairement le film sur ses épaules, chargé de lui imposer son rythme et ses brusques accélérations, Jim Carrey réussissait là son accession à des rôles dramatiques. Weir peut bénéficier aussi bien de son registre excessif, lorsqu'il joue le rôle qu'on attend de lui, et de sa sensibilité lorsqu'il se laisse aller à écouter son cœur. Devenu l'un des acteurs hollywoodiens les plus bankables après ses comédies cartoonesques et le succès de The Mask, Carrey poursuivra sur cette trajectoire qui culminera avec les géniaux Man on the moon et Eternal sunshine of the spotless mind. Dans le rôle du père créateur, Ed Harris en impose une nouvelle fois, faisant passer dans son regard une richesse d'intentions qui le rendent vraiment émouvant, personnage finalement plein d'amour et demeurant pourtant solitaire et à distance de sa création. Et, preuve là encore de la profondeur du propos, il n'a sans doute pas tout à fait tort en disant que le monde réel est peut-être tout autant fait de mensonges que celui artificiel qu'il s'efforce au moins de maîtriser. Son dernier échange où il voit sa créature, son fils, lui échapper est assez touchant, très finement mis en scène dans la façon de positionner les deux personnages. Et puis on notera l'emploi réussi des morceaux de Philip Glass, qui trouvent une belle harmonie avec cet environnement où froideur et chaleur se conjuguent.
DOSSIER PETER WEIR :